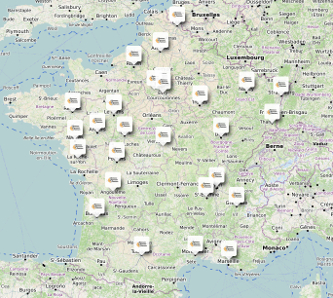Mehdi Khamassi est chercheur en sciences cognitives au CNRS, travaillant dans un laboratoire de l’Université de la Sorbonne. Il y co-animait jusqu’à récemment avec Frédéric Decremps et Emmanuel Guigon un enseignement sur la démarche scientifique et l’esprit critique. Lors de l’émission Zoom Ecologie du 6 octobre 2019, nous avons discuté avec lui de la place de la publicité dans l’espace public, de la « liberté de (non-)réception », des écrans numériques et de l’importance de prendre « son » temps pour prendre des décisions et agir en citoyen·ne conscient·e et averti·e. Nous publions ici des extraits de cette entrevue.
Jeanne Guien : Vous avez à plusieurs reprises publié des tribunes, témoigné dans des procès et soutenu des activistes antipub comme les Déboulonneurs, des gens qui ont barbouillé ou recouvert des affiches publicitaires. Dans ces différents procès, vous en appelez à la reconnaissance de la liberté de réception et de non-réception, corollaire selon vous de la liberté d’expression. Qu’est-ce que ça signifie ?
Mehdi Khamassi : Premièrement, je n’ai pas inventé ce terme : la paternité en revient à certaines des associations impliquées dans le débat autour de l’omniprésence de la publicité dans notre environnement, comme Résistance à l’Agression Publicitaire. Fondamentalement, la liberté de (non-)réception signifie qu’on est libre, dans un espace public, de pouvoir décider si l’on souhaite ou non recevoir de la publicité. On peut avoir envie de publicité parce qu’on ne sait pas quoi acheter, qu’on veut faire un cadeau ou plein d’autres raisons. Mais à d’autres moments, on est fatigué·e, on revient de sa journée de travail, ou tout simplement on n’en a pas envie, alors on doit être en mesure de ne pas recevoir de publicité. L’idée est que recevoir de la publicité corresponde à une démarche active.
Sur ces sujets, je témoigne régulièrement en tant que scientifique car certaines parties de mes recherches peuvent faire écho à ce genre de notions. Je fais des recherches en sciences cognitives – donc essayer de comprendre comment fonctionne notre pensée – et en particulier en neurosciences – quels sont les mécanismes dans notre cerveau qui nous permettent de percevoir l’environnement, l’interpréter, et décider d’agir en fonction de ces informations. La recherche dans ce domaine a dégagé un certain nombre de connaissances sur les différents processus cognitifs, qui montrent que les éléments saillants et répétitifs de l’environnement, comme la publicité de masse, ont un impact sur notre comportement (même lorsque cet impact n’est pas perçu consciemment). Les travaux scientifiques s’accumulent montrant que la quantité de publicité à laquelle nous sommes exposés quotidiennement pose des problèmes en matière de santé publique et d’autonomie décisionnelle. On peut prendre comme exemple la réception massive et quotidienne d’une grande quantité d’informations : même quand on n’en a pas conscience, notre cerveau traite ces informations, ce qui peut contribuer à amener à des situations de fatigue, de stress, et de surcharge cognitive. Je peux donc expliquer face à un tribunal pourquoi il est raisonnable, scientifiquement parlant, de parler de pression publicitaire, de réception de l’information de façon passive ou non. Et je peux venir parler de ce qu’on sait des potentiels enjeux sociétaux en termes de santé publique, car le fait d’être en permanence poussé à consommer entraîne notamment des problèmes d’obésité.
J. G. : Les sciences cognitives et les neurosciences apportent-elles un éclairage particulier sur les risques d’achat compulsif, d’addiction à la consommation ?
M. K. : Il y a d’abord le contenu de l’information à laquelle on est confronté : comment on nous influence à nos dépens en utilisant des associations émotionnelles, des slogans accrocheurs qui vont éviter de solliciter les parties « rationnelles » du cerveau (dans le langage scientifique, on dirait plutôt les fonctions délibératives et exécutives du cerveau), empêcher de prendre le temps de savoir si vraiment je souhaite ce produit ou cet événement…
Il y a aussi la question de la quantité de publicité : quand on parle d’impact potentiel sur la santé, par exemple l’obésité, c’est vraiment la question de la forme et de la fréquence du message, du matraquage publicitaire, qui est importante. Par exemple, mes travaux sont centrés sur les mécanismes dans le cerveau qui font qu’on peut être sujet à des conditionnements par répétition. Le plus connu est le conditionnement pavlovien qui explique qu’un stimulus (un son, une image) suivi sans arrêt d’une récompense, devient lui-même appétitif si on le répète assez de fois. Ça stimule le « système de récompense » dans notre cerveau, qui est un réseau d’aires cérébrales qui contribuent à intégrer la valeur émotionnelle (positive ou négative) des signaux reçus de l’environnement pour orienter nos comportements (répéter les actions qui mènent aux récompenses, tout en évitant les émotions négatives). Par la répétition, « s’engraine » petit à petit une trace mnésique qui va venir biaiser le comportement, sans même que ce soit volontaire ou conscient. Le sujet est en général totalement passif dans ce processus. Le système de récompense est très étudié. Par exemple, si je mange un aliment qui me rend malade, j’en suis dégouté·e et l’éviterai. A l’inverse, si des choses amènent à des bonnes situations, comme dans une pub le fait de montrer un cadre agréable, de la réussite sociale, des signaux associés pour nous à des valeurs positives, par cette répétition le système de récompense va construire une association qui va guider nos comportements, et faire que lorsqu’on se trouve dans une situation où on est face à deux produits, on va avoir envie d’en acheter un plus que l’autre, sans trop savoir pourquoi. Dans certaines études, des personnes souffrant d’obésité sont exposées à des publicités pour des produits ultra caloriques, et on observe une activation de leur système de récompense qui est plus forte que chez les personnes non sujettes à l’obésité. Cela veut dire que la trace mnésique est peut-être « engrammée » plus fortement, qu’il y a une association peut-être plus forte avec le comportement. Derrière ces processus, il y a tout un ensemble de mécanismes neuraux qu’on commence à mieux comprendre. Un bilan récent des recherches là-dessus a montré que si on interdisait la publicité pour les produits alimentaires pendant les programmes jeunesses à la télévision aux États-Unis, on pourrait réduire l’obésité infantile de près de 30%. On sait donc maintenant qu’il peut y avoir un impact direct sur la santé publique en régulant la publicité.
J. G. : En quoi les enfants sont-ils une cible particulièrement malléable du point de vue de vos études ? La lutte pour interdire la pub envers les enfants vous semble-t-elle une lutte réaliste, qu’on peut gagner ?
M. K. : Je sais que les démarches pour mieux réguler la pub envers les enfants progressent dans pas mal d’endroits. Par exemple en Californie, mais également plus récemment en France avec la loi Gattolin supprimant la publicité dans les programmes jeunesse de la télévision publique. Or ces démarches sont importantes car l’enfant ne perçoit pas la publicité avec la même lucidité que l’adulte, et peut donc (encore) plus facilement être manipulé.
Beaucoup d’éléments font que l’enfant n’a pas la même perception du réel que l’adulte. Il y a une confusion très grande entre le réel et l’imaginaire qui rend les enfants plus vulnérables à la publicité. De plus, les enfants sont moins capables que les adultes de prendre des décisions à partir d’une estimation délibérée des conséquences à long-terme de leurs actions (exemple : si je mange trop, je risque d’avoir mal au ventre plus tard, ou d’être en mauvaise santé sur le long-terme). Du coup, en voyant une publicité avec un contexte positif, des gens qui s’amusent, un enfant va désirer le produit qui est associé à cette situation de façon quasi mécanique. Les enfants peuvent rarement se dire spontanément qu’il y a une intention cachée derrière la pub, que des gens essaient de leur vendre quelque chose, et donc qu’il faut utiliser son esprit critique.
Mais ce n’est pas le seul problème : les adultes aussi sont influencés par la publicité à des degrés divers, et ce même quand on croit que ce n’est pas le cas. J’ai beau par exemple me poser tout le temps la question, faire des efforts pour ne pas regarder les écrans, ça reste très dur. Il suffit d’un mouvement sur l’écran pour qu’on tourne la tête sans même y penser, et qu’on reçoive du coup le stimulus publicitaire.
De manière schématique, la société actuelle me semble mettre beaucoup d’efforts, notamment par le système économique, pour susciter des réactions automatiques et émotionnelles à des stimuli pavloviens, que ce soit en politique (messages très simples, réactions émotionnelles, sentiments d’appartenance à un « clan » politique) ou pour des intérêts commerciaux. On pousse trop la société dans cette direction-là, plutôt que d’encourager/cultiver/développer la prise de temps pour réfléchir sur les choses, pour re-contextualiser l’information, pour développer l’esprit critique. Il y a cette phrase de Poincaré que j’adore : « douter de tout ou tout croire sont deux solutions également commodes qui l’une et l’autre nous dispensent de réfléchir. » Et ça me paraît crucial : j’accumule de mon côté des connaissances sur la pensée, la cognition, qui me semblent ensuite pouvoir nous aider à visualiser ce qu’on pourrait faire comme changement sociétal pour avoir une société où on prendrait plus le temps de réfléchir, de développer l’esprit critique, et donc d’être en fait des vrai·e·s citoyen·ne·s. La démocratie suppose que chacun·e soit capable d’avoir une information, de la digérer, la comprendre, pour ensuite se former une opinion. Donc l’esprit critique est nécessaire pour le bon fonctionnement de la démocratie.
Daniel Kahneman, un psychologue né en 1934, parle beaucoup de la distinction entre ce qu’il appelle Système 1 et Système 2. Quand on est poussé·e à prendre une décision rapide, c’est le Système 1 qui est plus émotionnel, plus rapide, et nous fait répondre rapidement, mais pas forcément très rationnellement ni très précisément. Et il y a à l’inverse un Système 2 qui, si je prends le temps de délibérer, de reformuler le problème sans pression de temps, permet de favoriser une pensée plus complexe et plus réfléchie. Si cette distinction est un peu schématique, elle donne une idée juste de la balance qui existe dans nos cerveaux entre différents modes de décision.
Et dans nos modèles de société et de démocratie, et d’ailleurs même dans les théories économiques, on présuppose que les citoyen·ne·s, les consommateur·rice·s, sont systématiquement en mode rationnel. Si on veut vraiment approcher un fonctionnement sain de démocratie, faisons donc en sorte qu’on encourage et qu’on favorise la capacité de chacun·e à prendre le temps d’utiliser ce système de délibération et pas simplement réagir de façon rapide à des stimuli. C’est aussi à chacun·e de faire cet effort, même si l’on nous presse à répondre, de refuser et prendre le temps de peser le pour et le contre, le pourquoi, les enjeux, etc. Surtout ne pas en rester à une réaction mais aller chercher plus d’informations, des sources contradictoires aussi. On a tous et toutes un « biais de confirmation », on va tous et toutes chercher les mêmes choses avec nos mêmes habitudes de pensée.
J. G. : En vous écoutant, je ne peux que penser aux effets des algorithmes sur les réseaux sociaux, qui nous proposent toujours les mêmes amis, les mêmes publications, en fonction de ce sur quoi on a cliqué par le passé. Comment articuler biais cognitif et biais médiatique ?
M. K. : C’est une question difficile. C’est un phénomène nouveau ces bulles, qui nous baignent d’informations de gens qui pensent comme nous. Avant même ce phénomène, il y avait déjà des biais d’algorithmes, mais plutôt liés à l’argent : si une marque a plus d’argent, son image va apparaître en premier. Donc l’information était déjà manipulée par ce biais économique. Qui d’ailleurs continue et s’ajoute aux autres biais dont on parle maintenant.
De mon côté, j’essaie à mon échelle de contribuer à des enseignements à l’esprit critique, afin que nous connaissions mieux nos propres biais cognitifs, que nous ayons quelques notions de psychologie pour mieux se connaître soi-même. Sur les réseaux sociaux, j’essaie de m’abonner à des journaux que je ne pas lis pas d’habitude, ou d’un bord politique qui n’est pas le mien, et je me force à en lire quelques articles de temps en temps. Il y a plein de petites stratégies, que chacun·e peut développer à sa façon. Mais il faut au moins faire savoir, décrypter le phénomène, pour apprendre à se connaître soi-même et comprendre la société dans laquelle on est. Mais ce n’est pas suffisant, face aux sommes colossales qui sont mises dans des perspectives marketing. Car l’objectif dans l’économie de marché c’est de vendre, et donc d’inciter les gens à acheter, et on voit où ça mène : jusqu’à polluer la planète, influencer des gens pour leur faire acheter des produits qui ne servent à rien et peuvent même être néfastes pour leur santé et l’environnement. Parce qu’il y a trop d’enjeux financiers derrière. Il y a donc un problème structurel.
J. G. : Vous dites dans une tribune de 2012, « une personne en Ile-de-France rapporte une cinquantaine d’euros par jour à l’industrie publicitaire sans le savoir ». Comme l’exprimait un slogan : « si c’est gratuit, vous êtes le produit ». Comment se saisir de ce qui est produit à travers nous sans qu’on nous demande notre avis ni qu’on nous en informe ?
M. K. : Ça me rappelle un des juges, lors d’un des procès des déboulonneurs de pub, qui m’avait dit en substance : « Mais au fond, nous vivons dans une société de marché. Il faut faire avec, quelque part ». Sur le moment d’ailleurs je n’ai rien trouvé à répondre, j’étais venu parler de science. Mais si j’avais eu le temps d’y réfléchir au préalable, j’aurai répondu qu’une économie de marché qui fonctionne bien se doit de considérer à la fois les coûts et les bénéfices, et de les mettre en perspective. S’il y a d’énormes bénéfices pour l’industrie publicitaire, mais qu’il en résulte des coûts pour la société, ne serait-ce qu’en termes de santé publique, des coûts qui sont donc socialisés, alors il y a un problème. Pour que la société fonctionne sur le long terme, il faut que nous réussissions à équilibrer les choses.
J. G. : Oui, cette tendance du capitalisme à « privatiser les bénéfices et socialiser les coûts ». Pourquoi, à votre avis, les écrans publicitaires sont-ils particulièrement dangereux, outre leur consommation d’énergie énorme ?
M. K. : Déjà, il y a le problème de la réception passive de publicité, qui est un problème général, commun aux affiches non animées. Mais surtout, il y a aussi la question de l’attraction de l’attention qui est beaucoup plus importante avec un écran. Vous faites bouger, clignoter, une lumière forte, parfois imprévisible. Si vous marchez dans le métro et qu’un écran sur le côté produit du mouvement, vous allez avoir une erreur de prédiction dans votre cerveau, donc quelque chose qui va vous donner envie d’analyser. Ce sont encore des processus automatiques, des routines qui n’accèderont pas forcément à la conscience : notre cerveau est en permanence en train de prédire les choses dans notre environnement et de mesurer des erreurs de prédiction pour nous dire si quelque chose d’imprévisible ou d’inattendu s’est produit autour. Avant même de pouvoir analyser de façon sémantique, le cerveau se demande pourquoi quelque chose d’inattendu s’est produit. Le mouvement est quelque chose de crucial : on pense qu’on a développé au cours de l’évolution des mécanismes de « paranoïa » pour nous permettre de mieux survivre. Quand on se balade en forêt, on entend le vent dans les feuilles, on se demande d’abord si c’est une personne animée. Et c’est très bien car on pense que ceux parmi nos ancêtres qui avaient cette réaction-là étaient ceux qui détectaient plus vite les prédateurs et s’enfuyaient le plus vite. Ils avaient donc plus de chance de survivre et de transmettre leurs gènes. De façon similaire, il y a un phénomène qui s’appelle la « paréidolie », qui consiste à voir des visages dans des formes aléatoires même quand il n’y en a pas – les nuages, mais pas seulement. Si vous vous baladez et qu’il y a quelque chose qui pourrait avoir une forme de deux yeux, un nez, une bouche, vous avez tout de suite un a priori qu’il s’agit peut-être d’un agent animé, donc peut-être d’un danger. Ceci vous pousse automatiquement à y faire attention et à l’analyser pour en savoir plus : est-ce que c’est un danger ou pas ? Donc ça attire l’attention. Tous ces processus automatiques peuvent se déclencher plus facilement dès lors qu’une publicité induit du mouvement. Et ceci peut contribuer à accroître momentanément notre stress, car le stress est un mécanisme qui nous permet de réagir plus vite en cas de danger.
Pas mal d’éléments suggèrent qu’il y a plusieurs niveaux auxquels les écrans nous influencent : surcharge cognitive, attention, autonomie décisionnelle… Et tout ça s’accumule, et à grande échelle, ça peut avoir un coût négatif sociétal très important. D’ailleurs ça en a un, mais on n’est pas encore capables de le mesurer précisément, seulement une sous-partie de ce coût pour l’instant.
J. G. : Dans un épisode de Black Mirror, un jeune homme vit et dort au milieu d’écrans. Il travaille dans une société totalitaire où les meilleurs passent à la télévision, et les autres pédalent pour produire de l’énergie. Sa récompense pour son show à la télé, c’est d’avoir une fenêtre qui donne sur des arbres, et non plus un écran. Est-ce que la nature est reposante, par cette absence de signaux permanents ?
M. K. : Je ne vais pas simplement dire de façon triviale que « la nature c’est reposant, c’est super ». Car ces réflexes (détecter si c’est un prédateur ou pas), nous les avons développés dans la nature. Néanmoins, justement, notre appareil cognitif a évolué sur la plus grande partie du temps évolutif humain, dans la nature. La période où les humains vivent en milieu urbain correspond à un moment très court dans l’évolution de l’humain. Si on vivait pendant des siècles, des milliers d’années, des générations et des générations dans les villes, il pourrait y avoir petit à petit quelques petites adaptations de notre cerveau. Mais globalement, à l’heure actuelle, nous utilisons le système cognitif qui résulte de notre évolution en milieu naturel, et qui nous a permis d’y survivre. Ça ne veut pas dire qu’il faut arrêter de vivre dans des villes. Mais qu’il faut au moins prendre des précautions et se demander quels sont les biais que cela induit. Aller faire un tour en forêt, c’est très relaxant. En effet la quantité d’informations y est moindre. Et il y a la valeur symbolique de la nature, se déconnecter de ses soucis, de la vie. Il y a également la réduction du bruit, car le problème du bruit en milieu urbain est connu et il est très important.
J. G. : Du fait d’avoir accompagné différents procès, est-ce que vous arrivez à voir une différence dans le niveau de répression de ces mouvements ? En septembre, des décrocheur·se·s ont été acquitté·e·s au nom de l’état de nécessité, ce qui est quand même une reconnaissance publique du fait que la cause écologique valide la désobéissance civile. Alors est-ce qu’il y a plus de répression ?
M. K. : Sur les quelques procès auxquels j’ai participé, je ne peux pas faire d’évaluation de tendance. Pour moi, ce qui a été frappant, c’est à quel point la décision du tribunal semblait dépendre des personnalités des juges. Un des juges, qui semblait plus sensible à la cause, avait laissé s’exprimer longuement les militant·e·s, les témoins, laissé chacun·e exposer des éléments, et il y avait eu relaxe ce jour-là. Mais un autre juge n’était pas du tout sensible à la cause et se focalisait sur le fait que les personnes en face de lui avaient fait quelque chose d’interdit, et les traitait du coup comme des délinquant·e·s. Il ne voulait pas comprendre que ces personnes avaient délibérément et de manière désintéressée fait cette action, qui plus est non-violente et induisant des dégradations mineures (la peinture a pu être nettoyée en 1/2 heure), car elles voulaient ceci: un débat pour tenter de faire avancer cette cause. J’avais moi-même l’impression d’être sur le banc des accusé·e·s, alors que j’étais simplement « témoin de moralité ». J’étais tout le temps coupé, tout le temps renvoyé à ne pas digresser.
Le deuxième aspect qui m’a frappé, c’est (un peu comme l’histoire des faucheurs d’OGM) qu’on a l’impression qu’il y a un temps long (10 ans, 20 ans, 100 ans) pendant lequel des gens prêchent dans le désert pour dire qu’il y a un problème sociétal, et s’entendre répondre que leurs actions sont illégales. Mais finalement, à force de susciter le débat, on se met à se dire que peut-être iels l’ont fait sans intérêt personnel, et que c’était important. On peut être d’accord ou pas. Libre à chacun·e. Mais on peut comprendre qu’il y a besoin d’un débat, plutôt que de laisser la société glisser progressivement sous le guidage d’intérêts à court terme. Alors on se demande : pourquoi ce débat n’a-t-il pas eu lieu plus tôt ? Peut-être parce que, comme je le disais précédemment, et comme beaucoup l’ont dit avant moi, la démocratie est un combat permanent, du moment que ce combat est constructif et vise l’intérêt général.

 Votre don est notre force
Votre don est notre force